Introduction
Ce sujet est particulièrement vaste, car les argiles, on le verra, constitue une famille de minéraux très diversifiée, et leurs utilisations, surtout aujourd'hui, sont tout aussi variées. On n'en indiquera ici que quelques-unes. Mais on peut noter immédiatement que les argiles, en tant que matériau d'origine des poteries et des briques, représente sans doute, après la pierre taillée ou polie, et le bois, l'un des tout premiers matériaux naturels utilisé par l'espèce humaine.
Il nous faudra d'abord définir les argiles, ce qui peut déjà se faire de plusieurs manières selon que l'on parle d'argiles en tant que minéraux ou en tant que roches contenant majoritairement lesdits minéraux. La description des minéraux argileux permettra d'en dégager les principales propriétés, qui éclaireront les utilisations de ces matériaux. On abordera ensuite leurs modes de formation, en remarquant que les minéraux argileux sont exclusivement cantonnés à la partie la plus superficielle de la croûte terrestre. Ce n'est qu'ensuite que l'on détaillera certains intérêts des argiles.
1/ Un premier problème, la définition des argiles
A/ Les argiles en tant que roches.
Caractères généraux.
On parle, dans le langage courant, d'argiles, pour désigner des roches sans cristaux visibles, donc constituées de particules très fines, et aux propriétés mécaniques particulières, notamment en présence d'eau: elles ont un contact collant, absorbent l'humidité, et sont alors plastiques (malléables).
La petitesse de leurs cristaux impose des méthodes d'études spécifiques, en laboratoire.
Cette particularité sert aussi de
première base
pour une définition plus rigoureuse.
2) Définition granulométrique.
Les échelles granulométriques, qui
définissent les particules constitutives des roches
sédimentaires selon un critère de taille, sont
nombreuses, mais identifient généralement les
argiles
comme les particules les plus fines : la classification de
Wenthworth appelle argiles (clays ) les particules
inférieures à3,9 micromètres (cf.
figure ci
dessous ).
3) Caractéristiques chimiques et variétés.
En tant que roches sédimentaires, les argiles sont des mélanges de minéraux, dominés par un type, dit minéraux argileux (cf. plus loin), auxquels elles doivent leurs propriétés. Néanmoins, en fonction des autres minéraux présents,de la texture de la roche, de son aspect ou de ses propriétés, de son contenu en matière organique, ou de l'utilisation qu'en fait l'homme, de nombreuses catégories sont distinguées :
D'après la texture :argilites (roches argileuses sédimentaires non litées), shales (roches litées), argiles schisteuses ou schistes argileux, etc...
# D'après les minéraux associés : argilites calcaires (ou marnes), marnes dolomitiques, argilites sableuses, marnes sableuses, shales sableux, marnes à gypse, etc...>
# D'après le faciès : argilites bigarrées, marnes rubanées, argiles à varves, argiles plastiques, argiles à silex, etc...
# D'après la matière organique contenue : marnes à Foraminifères, shales à poissons, argilites à plantes, shales bitumineux, etc...
# D'après son usage par l'homme : argiles réfractaires, marnes à ciment, argiles smectiques (terre à foulon, bentonites, argiles à dégraisser), etc...(cf. chap.3)
Enfin, une analyse chimique globale des roches argileuses peut se reporter sur un diagramme triangulaire, mais cela ne permet pas de séparer différentes classes d'argiles.
B/ Les argiles en tant que minéraux.
1) Aspect et définition microscopique.
L'examen de roches argileuses au microscope montre que la plupart des minéraux sont des paillettes silicatées, en général plus petites que les micas, mais apparentés à ceux-ci, physiquement et optiquement. On définit donc cette fois les argiles en tant que famille minérale appartenant aux phyllosilicates. Pour éviter les confusions, il est donc préférable de parler de "minéraux argileux", ou phyllites.
Au microscope optique toujours, certains de ces minéraux peuvent être distingués :
# la kaolinite, en petits
feuillets hexagonaux
s'empilant parfois en boudins,
# la chlorite, de couleur verte
caractéristique,
# attapulgite et sépiolite
en
fibres
Ces cas sont cependant rares, d'où la nécessité de méthodes d'études spécifiques.
2) Méthode d'étude: la diffraction des rayons X.
Cette méthode n'est pas exclusive aux argiles, mais
s'y
applique en priorité.
Elle consiste à envoyer un faisceau de rayons X sur les
minéraux. Les minéraux argileux sont
composés
de feuillets silicatés superposés : ceux-ci
réfléchissent les rayons X qui les atteignent
sous
une incidence donnée, et dans une direction
donnée.
Pour un faisceau monochromatique de longueur d'onde donnée, λ, abordant, sous un
angle Θ une famille de
plans atomiques,
séparés les uns des autre d'une distance d
(distance
réticulaire), les atomes diffusent cette onde dans toutes
les directions et, dans le cas où les rayonnements
renvoyés par les plans successifs sont en phase,
l'intensité correspondante est suffisante pour
être
mesurée. La différence de marche δ
entre deux rayons réfléchis par
deux plans consécutifs étant :
δ = OH + OH' = 2.d.sin
Θ
Ces deux rayons sont en phase si δ =
n.λ.
D'où la relation dite Loi de Bragg : δ = 2.d.sin Θ= n.λ
En mesurant les angles Θ de
réflexion du rayonnement incident, on peut, connaissant λ,
déterminer les distances
réticulaires d d'un réseau cristallin,
caractéristiques d'un minéral donné.
Les λ utilisées vont,
habituellement, de 0,15 à 0,19 nm.
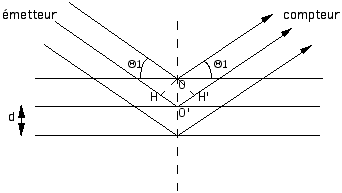
3) Formule générale des minéraux argileux.
Les minéraux argileux sont constitués
de silicium,
d'aluminium, d'oxygène et d'ions hydroxyles OH,
organisés en couches, de deux types selon que les
oxygènes ou hydroxyles sont associés en
tétraèdre ou en octaèdres. Les couches
de
tétraèdres sont dominés par Si 4+
et O-. Celles d'octaèdres sont
dominées
soit par Al 3+ (= couches
dioctaédriques, 2
atomes suffisent pour occuper les 6 sites des sommets de
l'octaèdre) et OH-, soit par Mg 2+
(=
couches trioctaédriques,3 atomes de magnésium
sont
nécessaires à l'équilibre des charges
des
octaèdres).
Les couches d'octaèdres et de
tétraèdres
s'accolent selon des plans, par mise en commun d'O et d'OH,
d'où la structure en feuillets séparés
par des
espaces interfoliaires.
Du fait de possibles substitutions partielles de Si 4+
par Al 3+dans les
tétraèdres, de Al
3+ par Mg 2+, Fe 2+
ou Fe
3+, dans les octaèdres, il peut
apparaître
des déficits de charges positives, déficits qui
sont
alors compensés par l'insertion de cations ou d'eau dans les
espaces interfoliaires.
De tout cela découle une formule
générale
conventionnelle des minéraux argileux, du type :
C/ Classification schématique des minéraux argileux.
1) Critères de classification.
# Nombre de feuillets :
On distingue trois types d'accolement:
- 1 couche d'octaèdres (O) et 1 couche de
tétraèdres(T): phyllites 1/1 ou T.O.
- 1 couche d'octaèdres,
insérée entre
deux couches de tétraèdres: phyllites 2/1 ou
T.O.T.
- un feuillet de type 2/1 avec une couche
d'octaèdres
supplémentaires, isolée dans l'espace
interfoliaire:
phyllites2/1/1 ou T.O.T.O.
# Substitutions atomiques
: On
subdivise les trois catégories
précédentes
selon le taux de substitution des atomes et leur lieu (Si
<-->Al ou Al <--> Mg, Fe: substitution
dioctaédrique ou trioctaédrique), et la nature
des
cations compensateurs.
# Espacement des feuillets :
Selon les minéraux, et les constituants qui se logent dans les espaces interfoliaires, ceux-ci présentent des largeurs différentes.
2) Description des grandes catégories.
# Kaolinite : C'est une phyllite 1/1 sans substitution. Le feuillet est neutre. La distance de la surface d'un feuillet à celle du feuillet suivant est de 0,7 nm (7 angströms (Å)), sa formule est : Si2 Al2 O5 (OH)4 ou Si4 Al4 O10 (OH)8.
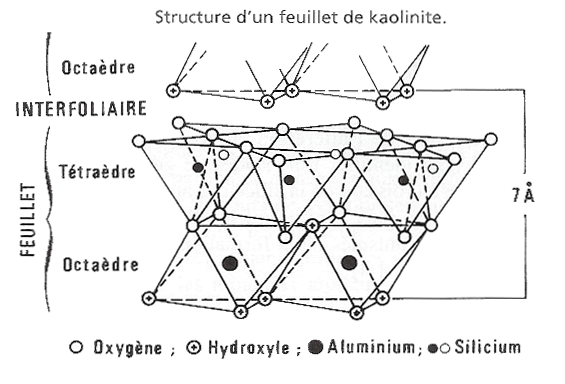
# Illites : phyllites 2/1 , avec des substitutions foliaires, compensées électriquement par des ions K en position interfoliaire. L'équidistance moléculaire est de 1 nm. Formule générale : (Si4-x Alx)(Al,M1,M2)2 O10 (OH)2 K. La glauconite est le pôle ferrique de l'illite.
# Smectites : (anciennement montmorillonites) : le modèle est le même que celui des illites, mais avec une moindre organisation dans l'empilement des feuillets : chaque feuillet est tourné dans son plan par rapport au précédent. Ce désordre et la faible charge des feuillets facilitent leur écartement. Dans cet espace peuvent se loger divers cations, de l'eau et des molécules organiques d'encombrement divers, d'où une équidistance réticulaire variant de 1 à 1,8 nm, et la grande variété des minéraux de cette famille.
Notons qu'en géologie économique, on nomme bentonites les smectites exploitables commercialement. Pour le sédimentologue, par contre, ce terme désigne un lit argileux issu de l'altération de cendres volcaniques, et pouvant contenir des smectites, mais aussi de la kaolinite, des minéraux interstratifiés et des zéolites.
# Chlorites : leur structure est, là encore, semblable à celle des illites et des smectites, mais l'espace interfoliaire est occupé par une couche d'hydroxydes de natures variées. Cette couche octaédrique supplémentaire est stable, et l'équidistance réticulaire est fixe, et de 1,4 nm.
# Minéraux argileux interstratifiés : dans ces minéraux alternent des feuillets avec des espaces interfoliaires de largeurs différentes, déterminables seulement si cette alternance est régulière. Ces minéraux sont les étapes de transformation d'un minéral argileux à l'autre.
# Minéraux en lattes, sépiolite et attapulgite : ils sont composés, non de feuillets, mais de rubans à trois couches accolés en quinconce. La couche octaédrique comprend 8 cations (Mg) pour la sépiolite, 5 pour l'attapulgite (Mg, Al, Fe).
3) Classement récapitulatif.
Deux modes de classifications sont proposés ci-dessous.
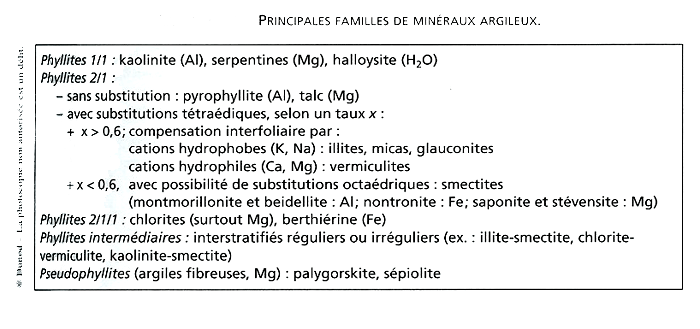
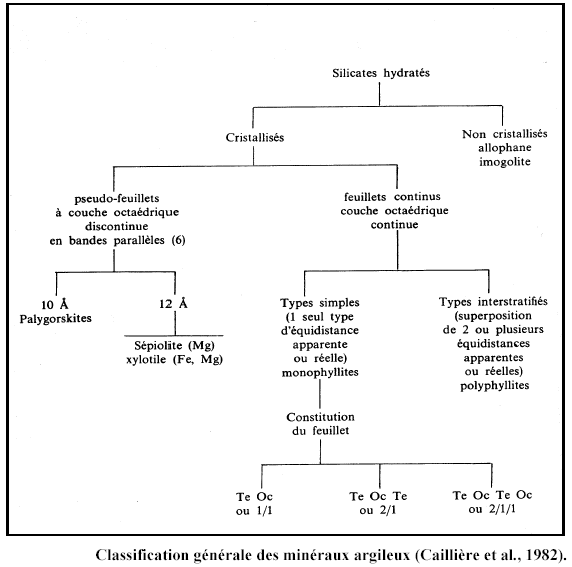
En conclusion de ce chapitre, on doit noter que les argiles ne se rencontrent, en tant que telles, que dans les ensembles sédimentaires non métamorphisés (à l'exception du cas de l'hydrothermalisme, cf. plus loin) : elles sont donc spécifiques du domaine externe de la Terre. On doit donc maintenant examiner les modalités de leur(s) formation(s).
